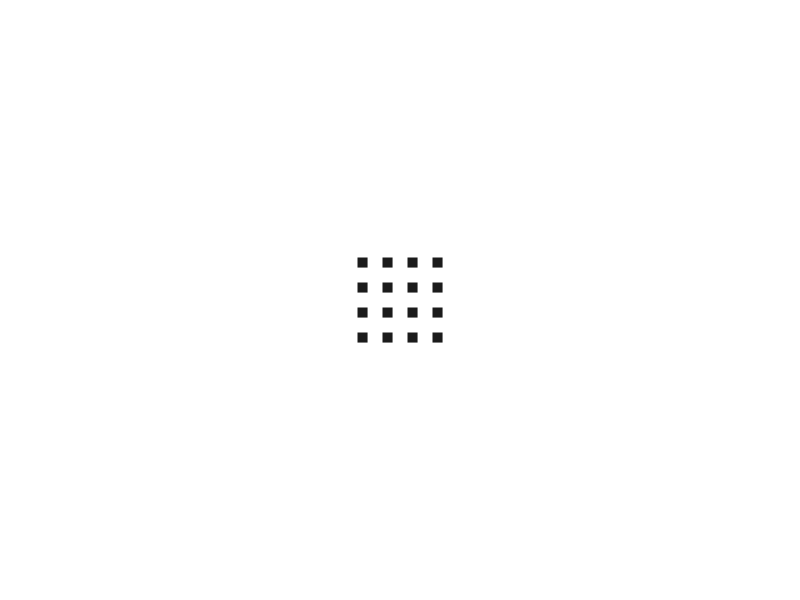13•11•24
Orchestre
Musiciens exilés : le défi de l'intégration

Orpheus XXI, orchestre de musiciens migrants lancé en 2016 par Jordi Savall à la suite d’un concert donné dans la « jungle » de Calais. Crédits photo : Orpheus XXI
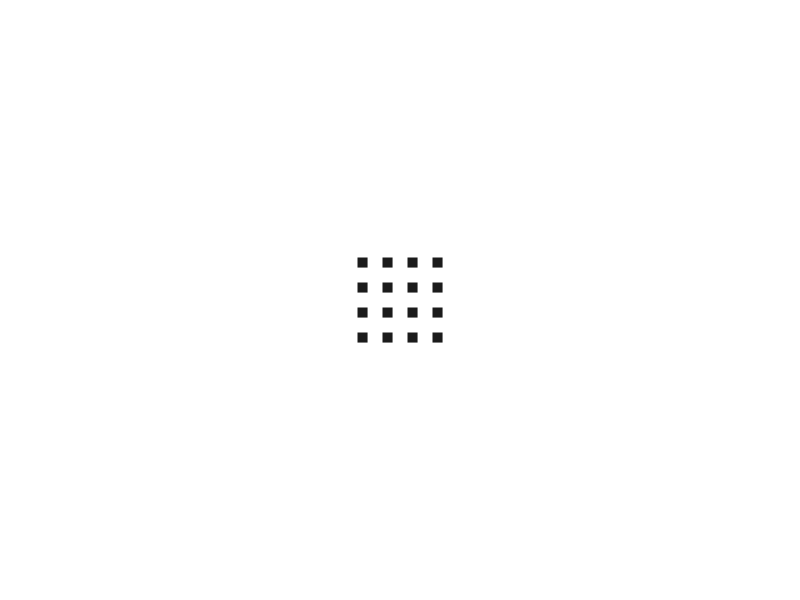
En lien avec l'article
Commentaires